Plymouth 1940 PT-105
Ecrit par René St-Cyr | 2011-10-05

Nous, ici au Québec, nous restons bouche bée, quand nous voyons une camionnette porter le nom Plymouth. Très peu sont au courant que Plymouth a déjà fabriqué des véhicules commerciaux. C’est pourtant un fait bien établi, Plymouth a effectivement produit des véhicules commerciaux, et ce, dès le début de son histoire. Nous pouvons toutefois justifier notre ignorance par le fait que ces véhicules n’étaient réservés qu’au marché américain et qu’ils n’ont jamais été vendus hors des frontières des États-Unis.
Au Canada, les concessionnaires Dodge-Chrysler vendaient des camions Dodge, alors que les concessionnaires Plymouth-DeSoto vendaient des camions Fargo.
Si nous remontons le temps jusqu’en 1924, nous retrouvons Walter Percy Chrysler fort occupé à fonder sa compagnie éponyme. Comme il avait oeuvré pendant plusieurs années, en tant que président de la Division Buick, chez General Motors, il voulait construire la sienne sur le même modèle que celui de GM. Pour ce faire, il utilisa les bases chambranlantes de la compagnie Maxwell-Chalmers. C’est ainsi que les premières Chrysler étaient en fait des Maxwell déguisées. Afin de compléter sa gamme, il ajouta, en 1928, la Plymouth pour occuper le marché de l’entrée de gamme, contre Ford et Chevrolet, la DeSoto pour contrer la Buick, dans la gamme intermédiaire, alors que la Chrysler Imperial s’opposait déjà à Cadillac, depuis 1924. Comme il voulait être sur tous les fronts, la même année il fonda la compagnie Fargo Motor Corporation, pour occuper le marché des véhicules commerciaux.

Puis, coup de tonnerre dans un ciel bleu. La Dodge-Brothers, qui appartenait au groupe d’investisseurs Dillon, Read & Company, depuis le début des années 20, comme suite de la mort de John et Horace Dodge. Le groupe Dillon & Read décida de mettre la Dodge-Brothers en vente. Walter Chrysler, qui suivait ce dossier de près, s’en porta acquéreur, en 1928, au prix de 170 millions de dollars. C’était le canari qui avalait le chat. En achetant la Dodge-Brothers, Chrysler mettait la main sur un immense complexe industriel, qui comprenait hauts-fourneaux, fonderie, usines, réseau de concessionnaires, etc. En plus, c’était une marque connue et respectée.
Il y avait toutefois un problème de dédoublement. Dodge arrivait avec ses propres véhicules commerciaux. De plus, la compagnie avait pris le contrôle de la compagnie Graham-Brothers, qui fabriquait des camions en utilisant des Dodge, alors que du côté de Chrysler, la division Fargo était prête à fabriquer son premier véhicule, en septembre, en utilisant une version de la Plymouth.
La Fargo était offerte en deux versions. La première, d’une capacité d’une demi-tonne, portait le nom de Packet. Elle était bâtie sur un châssis de Plymouth d’un empattement de 109 pouces. Elle était motorisée par le quatre cylindres de la Plymouth Q. Son prix de vente était fixé à 795,00 $. À partir de mars 1929, le moteur six cylindres de la DeSoto fut utilisé. Elle était construite en empruntant des pièces de mécanique et de carrosserie de Plymouth, DeSoto et même Chrysler.

La version, trois quarts de tonne, était construite sur le châssis de 112 3/4‘’. Elle était motorisée par le moteur six cylindres de la Chrysler Modèle 65 et portait le nom de Clipper. Au mois de juin 1929, un camion d’une tonne portant le nom de Freighter fut mis sur le marché. Il était, lui aussi, motorisé par le 6 cylindres DeSoto. Bientôt, la forte compétition des camions Dodge et les conditions économiques désastreuses apportées par la débâcle financière de 1929 entravèrent sévèrement les ventes de la Fargo. La production du Clipper cessa en mars 1930, celle du Freighter en octobre, alors que celle du Packet continua jusqu’en novembre.
À la suite de la disparition de Fargo et de l’absorption de la marque Graham-Brothers par Dodge, cette marque était devenue la seule à fabriquer des véhicules commerciaux au sein de la Chrysler Corporation. Mais, alors pourquoi la marque Plymouth était-elle revenue dans ce créneau du marché, en 1935 ?
La réponse se trouve dans la stratégie de vente de la marque Plymouth. Afin de faire augmenter les ventes, au cours de la crise, les gestionnaires avaient décidé, au début de l’année 1930, que la marque Plymouth, en plus de son propre réseau de concessionnaires, serait distribuée à tous les concessionnaires Dodge, DeSoto et Chrysler. La Plymouth obtenait ainsi plus de 7 000 points de vente. Cette stratégie a permis de faire grimper la Plymouth au troisième rang du palmarès des ventes, en 1931, derrière Ford et Chevrolet. Toutefois, malgré le succès qu’avait connu cette stratégie à court terme, à long terme, elle eut un effet pervers qui ultimement enclenchera la longue agonie de la marque Plymouth. Dès que l’économie eut repris de la vigueur, les décideurs auraient dû changer de stratégie, car les concessionnaires des marques Dodge, DeSoto et Chrysler préféraient forcer la vente de ces marques, qui elles, avaient un prix de vente supérieur à celui de la Plymouth, la marge de profit était donc plus élevée. Ainsi, la Plymouth était toujours la laissée pour compte, dans la salle d’exposition de ces derniers.

C’est donc cette structure de vente qui força Plymouth à réintégrer le marché des véhicules commerciaux. Par exemple, le concessionnaire Dodge-Plymouth avait des camions Dodge à vendre, alors que les concessionnaires DeSoto-Plymouth et Chrysler-Plymouth n’avaient rien à offrir, dans ce domaine. En leur donnant des véhicules commerciaux de marque Plymouth, les concessionnaires étaient devenus tous égaux.
Le retour de Plymouth dans le marché des véhicules commerciaux, en 1935, s’est fait avec prudence. Ils ont commencé par utiliser des berlines deux portières, lesquelles étaient modifiées en leur ajoutant une porte à l’arrière, pour permettre et faciliter le chargement et le déchargement des marchandises.
Puis, en 1937, Plymouth y allait à fond de train, en mettant sur le marché une camionnette. Elle était montée sur un châssis de 116 pouces et motorisée par un six cylindres de 70 ch. Elle portait le nom de PT50. Son prix de vente était fixé à 525,00 $ pour la camionnette complète et 495,00 $ sans la boite. Cette dernière mesurait 6 pieds de long par 47,5 pouces de large. L’équipement de base de cette camionnette était des vitres de sécurités à toutes les fenêtres, un parechoc avant et une roue de secours montée sur l’aile avant du côté droit. Une liste d’options comprenait une roue de secours à gauche, un essuie-glace du côté droit, un parechoc arrière, des butoirs de parechoc, un cadre chromé pour le parebrise. La réception de cette camionnette a été enthousiaste, car l’année 1937 a été la meilleure année pour ses ventes.
Les modèles 1938 ont été nommés PT57. Ils ont profité de quelques modifications d’ordre esthétiques, d’une augmentation de prix plutôt costaude, à 585,00 $. La liste des options avait été allongée par l’ajout d’un régulateur de vitesse, un radiateur chromé, des phares chromés et un filtre à air avec bain d’huile.

Les modèles 1939, connus sous le nom de PT81 avaient fait les frais de beaucoup de changements apportés à leur carrosserie. Il leur devenait de plus en plus difficile, de cacher le fait qu’ils étaient en fait des camionnettes Dodge déguisées en Plymouth. La roue de secours était dorénavant placée et cachée à l’arrière, entre les longerons du châssis. Chez Plymouth, on se vantait d’avoir la plus grande boite sur le marché avec une longueur de 78 pouces et une largeur de 48 1/4.
Les modèles 1940 ont été nommés PT125. La puissance du moteur avait été portée à 79 ch, alors que son prix de vente était fixé à 585, $. Très peu de changements cosmétiques avaient été apportés. Ceux qui se remarquent le plus sont les feux de position, qui avaient été placés sur le dessus des phares et l’ajout de trois barres chromées à sa calandre. Le changement d’emplacement des feux de position avait été rendu nécessaire par l’adoption des phares scellés.
Notre vedette, appartenant à M. Martin Thibault, une camionnette Plymouth PT105. Elle est donc très rare, car dans un premier temps, elle n’a jamais été vendue au Canada et d’autre part, elle n’a été fabriquée qu’en seulement 6 879 exemplaires.




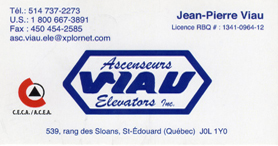

%20Inc.jpg)


